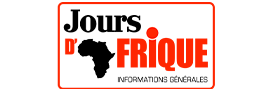« C’est un héritage énorme », s’est dit Alex Moussa Sawadogo après avoir finalement accepté de prendre les commandes du Festival panafricain de cinéma de Ouagadougou (Fespaco), dont la 27e édition se tient du 16 au 23 octobre 2021.
Âgé de 47 ans, il a beau avoir roulé sa bosse dans de nombreux festivals, en tant que directeur de programme, membre de jury, et surtout créateur du Festival des films d’Afrique de Berlin (Afrikamera) en 2007, le voilà aux manettes d’un poids lourd continental.
Lors de la précédente édition, en 2019, le Fespaco avait fêté ses 50 ans. « Il fallait l’inscrire dans un nouveau cinquantenaire, je me suis jeté à l’eau », dit-il dans un spacieux bureau orné de toiles d’artistes du cru, où l’on frappe sans cesse à la porte pour « une urgence ».
Pour Le Point Afrique, il livre ses impressions, à mi-parcours de sa première édition en tant que directeur général.
Alex Moussa Sawadogo : Habituellement, quand on dit « Fespaco », ça se traduit en image par la statuette de l’Étalon de Yennenga, le grand prix du festival. C’est une photo qu’on retrouve de façon récurrente dans les supports de communication et les médias. Mais quand j’ai pris les rênes de la direction générale du Fespaco, il m’a paru important que la communication soit basée sur un aspect fondamental du festival. Tout le monde ne sait pas qui est Yennenga, et quel rapport cette figure entretient avec le monde d’aujourd’hui. Yennenga est d’abord notre ancêtre. Une femme forte, une amazone, dont le fils Ouedraogo est dépositaire du royaume mossi. Elle incarne des valeurs sur lesquelles on s’appuie pour exécuter nos projets, comme la ténacité, le courage, l’efficacité.
Cette figure féminine, par laquelle j’ai souhaité marquer ma première édition en tant que directeur général, est aussi un clin d’?il aux femmes, pour les emmener au c?ur des métiers du cinéma. Je tenais enfin à ce que cette icône soit représentée par un artiste contemporain. En l’occurrence, il s’agit de Christophe Sawadogo, un artiste peintre burkinabè qui diffuse un discours très intéressant à travers ses ?uvres. Je lui ai donné les éléments de langage, et voilà ce qui en est ressorti.
Il y a aussi une symbolique guerrière dans cette affiche, qu’on a également perçue dans le spectacle de la cérémonie d’ouverture du Fespaco, ce samedi 16 octobre, en particulier dans les chorégraphies de Serge Aimé Coulibaly?
Oui, car je ne vais pas dire que nous sommes en guerre, mais nous sommes en situation de combat. Sur les fronts sécuritaire et sanitaire, et, plus généralement, contre tout ce qui mine nos sociétés. Et l’important est de pouvoir résister dans un pays comme le Burkina Faso. Il faut lutter.
C’est ce que vous aviez à l’esprit quand on vous a proposé la direction générale du festival en octobre 2020, dans un contexte où les violences d’acteurs armés ne cessaient de s’amplifier au Burkina Faso, et où la pandémie de coronavirus paraissait incontrôlable ?
Quand on m’a appelé pour me proposer cette offre, j’ai refusé. J’étais en plein confinement en Allemagne, en train de regarder Netflix en pyjama? J’avais enfin l’occasion de faire une pause et de consacrer du temps à ma famille, après avoir beaucoup travaillé et voyagé ces dernières années. Je suis resté sur ma position quand on m’a rappelé deux semaines plus tard.
L’idée d’une « mission impossible », en raison notamment des crises sécuritaire et sanitaire, vous a-t-elle aussi effleuré l’esprit ?
C’était un ensemble de choses. Quand j’accepte une mission, je m’engage à fond, mais j’ai besoin qu’on me donne la liberté d’agir et d’être entouré de collaborateurs qui croient en ma vision. Sur ces aspects-là, j’avais quelques craintes. Je savais aussi que j’allais être confronté à une situation très difficile, qu’il s’agisse de l’organisation du festival, mais aussi, plus essentiellement, de sa structure, de son management, sans parler de l’adversité relative aux crises sanitaire et sécuritaire. Et puis, la troisième fois qu’on m’a contacté pour me proposer la direction générale du Fespaco, on m’a dit « c’est la nation qui t’appelle ». J’ai donc fini par répondre présent, et j’ai immédiatement débarqué à Ouagadougou.
La thématique de cette 27e édition s’intitule « Cinémas d’Afrique et de la diaspora : nouveaux regards, nouveaux défis ». Pourquoi cet accent sur la diaspora ?
Le rôle joué par la diaspora dans la création artistique est énorme. Or, l’Afrique est un continent qui a très peu foi en sa diaspora. Ses membres sont perçus comme des privilégiés, des concurrents, jamais comme un atout pour pouvoir changer le modèle de gestion et de développement du cinéma. Pourtant, les producteurs et réalisateurs qui ont eu la chance de se former ou de travailler à l’extérieur font partie de ceux qui portent haut le flambeau des cinémas d’Afrique. Ce sont des Sénégalais, des Ivoiriens ou des Burkinabè qui sont partis, puis revenus pour créer, monter des projets. Ils ont reçu des distinctions à travers le monde, à l’instar d’Alain Gomis, de Mati Diop, de Philippe Lacôte. Regardez au Ghana, ce sont des ressortissants partis aux États-Unis ou en Angleterre qui sont en train de redynamiser l’industrie cinématographique. De la même façon, les réalisateurs nigérians dont les films sont sélectionnés sur des plateformes numériques ou dans les festivals sont issus de la diaspora. Il était donc temps de les intégrer pleinement dans notre vision du cinéma, en reconnaissant leurs films dans les compétitions, au Fespaco. Cela existait déjà, mais plutôt à travers la catégorie « le cinéma vu par » ? une section que j’ai d’ailleurs supprimée.
Cette année, le film Freda de la cinéaste haïtienne Gessica Généus concourt pour l’étalon d’Or Yennenga. Je considère qu’elle fait partie de la diaspora africaine.
Et quels sont les « nouveaux défis » à relever ?
Les formes de fabrication des films ont changé, de l’écriture à la distribution, en passant par le développement, et il faut que le cinéma africain puisse s’adapter à ces changements. Faire un film, ça ne se résume pas à prendre un calepin, écrire un scénario et commence à tourner. Il faut étoffer chacune de ces étapes pour espérer obtenir un financement, d’où la mise en place de laboratoires, d’incubateurs [Alex Moussa Sawadogo est directeur artistique de Ouaga Film Lab, un laboratoire de développement et de coproduction initié en 2016 par le collectif Génération Films, NDLR]. L’Afrique est actuellement le continent le moins représenté sur les plateformes numériques. Et c’est encore moindre pour les films d’Afrique francophone. Avec la fermeture en sus de salles de cinéma un peu partout sur le continent, il faut pouvoir se positionner sur ces canaux-là.
Le Burkina Faso semble préservé par cette fermeture de salles de cinéma? ?
Oui mais il n’empêche qu’il faut viser une meilleure représentation sur les plateformes numériques. D’autant que de nouveaux quartiers émergent, dans les périphéries, et qu’ils ne sont pas dotés de salles de cinéma. Aujourd’hui, on s’évade moins dans des salles obscures que sur sa tablette ou devant un écran de télévision connecté à Internet? Le modèle de création, de développement et de distribution du cinéma africain doit donc s’adapter à ces réalités.
Parallèlement à ce défi, vous avez défendu l’accès aux films dans les salles de cinéma, puisque vous avez refusé l’option d’un festival en ligne, avant que cette édition du Fespaco ne soit reportée au mois d’octobre ?
Oui car la population que je souhaite atteindre n’aurait pas eu accès aux films, compte tenu du faible débit Internet, et c’est encore une fois les internautes les mieux lotis qui auraient profité du festival. Cela ne sert pas notre objectif. Certains de mes collaborateurs ont insisté, mais j’ai laissé entendre que c’était inutile. Le Fespaco est un festival pour les Burkinabè.
Nous sommes quasiment les seuls sur le continent à avoir amené les gens dans les salles de cinéma depuis le début de la crise sanitaire. D’autres festivals ont essayé mais l’affluence était vraiment très faible. Je ne voulais pas organiser un festival de privilégiés, et les premières soirées nous montrent que la fréquentation des salles est très bonne, on fait le plein. C’était un de mes grands objectifs.
Le fait de maintenir un Fespaco bien réel ? et non virtuel ? est aussi une bouffée d’oxygène pour les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration ou des transports?
C’est pour eux aussi qu’on a reporté le festival. On aurait pu organiser un festival juste pour les Burkinabè en février-mars, mais en tirant un trait sur la venue de festivaliers étrangers en raison de la pandémie. Alors qu’en reportant en octobre, on estimait que nombre d’entre eux auraient été vaccinés, que l’État maîtriserait la situation sanitaire et se pencherait sur le dispositif sécuritaire à mettre en place. De fait, les hôtels sont aujourd’hui bondés, les commerces sont ouverts, on dénombre au moins 8 000 festivaliers officiellement accrédités? Le festival garde le cap des années précédentes. A priori, on va approcher l’affluence de 2019, à savoir 200 000 spectateurs au cours de la semaine.
Pourquoi avoir choisi le Sénégal comme invité d’honneur ?
C’était tout à fait légitime, vu la dynamique de la création audiovisuelle et cinématographique dans ce pays, vu son impact dans la sous-région mais aussi l’image du cinéma africain qu’il véhicule à travers le monde. Sur le plan politique, l’appui des autorités est très important, en matière de production, de développement des projets, d’écriture des scénarios. C’est encore un pays qui a réussi à mettre en place une coproduction qui bénéficie à d’autres pays, par exemple entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire, ou entre le Sénégal et le Burkina Faso, et ça fonctionne très bien. C’était donc évident d’inviter le Sénégal, d’abord, pour « le remercier » comme on dit au Burkina, pour lui faire honneur, et surtout pour que le continent voie qu’il est possible d’avoir une bonne politique dans le secteur du cinéma, dans l’intérêt de tous.
Quelle leçon en tirer ?
Il ne suffit pas de créer des fonds fictifs ou des fonds sans fonds. Il s’agit de prendre des décisions, de les assumer et d’aller jusqu’au bout. Certains pays africains ont adopté une politique ambitieuse pour développer la création et la production cinématographiques, mais dans la mise en ?uvre, ça ne suit pas, et notamment dans le choix des personnes compétentes pour ce type de mission. Car les autorités décident, mais il revient à ces techniciens et professionnels de l’image d’apposer leur vision, et c’est dans cette collaboration très serrée que le projet est fructueux. On a tendance à croire dans les administrations que les acteurs privés s’opposent aux acteurs publics, et de fait, il n’y a pas de cohésion entre eux. C’est regrettable. Car les privés sont sur le terrain, ils ont l’expertise. Sans harmonie entre ces deux types d’acteurs, on ne pourra pas atteindre nos objectifs, surtout en matière de financement. C’est vrai que les États peuvent abonder les fonds de création et de production, mais le secteur privé aussi. L’État peut donc accompagner, mais sans être pour autant le principal acteur si on veut bâtir une véritable industrie du cinéma en Afrique. (Le Point)