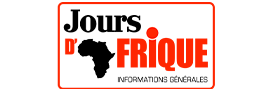De retour d’Indochine, de nombreux tirailleurs ont ramené au pays femmes et enfants, donnant naissance à la communauté sénégalo-vietnamienne. Au centre Raw Material Company, une exposition rend hommage à cette histoire méconnue.
Macodou Ndiaye a 66 ans mais lorsqu’il repense à la première fois qu’il a découvert le visage de sa mère biologique, il en a encore la chair de poule. « Dans son regard, je lisais de la souffrance, de la désolation. J’avais l’impression qu’elle me posait une question. Cela m’a beaucoup touché, même si je ne comprenais pas ce que je voyais ». Le jeune homme n’a pas vingt ans en 1975, lorsqu’il pose les yeux sur cette photo de sa mère, trouvée par hasard au domicile familial. Sur une deuxième photo, la même femme tient un nouveau-né dans ses bras. Au dos du cliché, cette mention : « Macodou et moi ». Dans une lettre d’amour adressée à son père, l’étudiant apprend alors que celle qu’il pensait être sa mère n’est pas celle qui l’a mis au monde. Il comprend aussi qu’il n’est pas né à Thiès, comme il le pensait, mais à Saïgon en 1955, dans ce qui ne s’appelle déjà plus l’Indochine, où son père tirailleur a combattu aux côtés de l’armée française.
Enfin, il comprend les quolibets de ses camarades de classe avec lesquels il se battait lorsqu’ils l’appelaient « le chinois » à cause de son teint clair et de ses yeux bridés. Il réalise aussi « l’omerta » qui régnait dans sa famille où son père, sous-officier de l’armée française, gardera le silence jusqu’à sa mort sur cette femme vietnamienne à qui il a fait un enfant. La vérité sur sa naissance, ses origines, Macodou Ndiaye l’apprendra en lisant les mots de sa mère, dont il sera séparé très tôt avant d’être rapatrié auprès de son père par la France. Il ne la verra jamais, et ne se rendra au Vietnam que douze ans après sa mort, pour y rencontrer sa famille vietnamienne.
De cette découverte qui a bouleversé sa vie, il ne parlera jamais directement avec son père. « J’ai vécu comme ça, j’ai eu mes gosses. Pour moi, l’essentiel était fait : je savais d’où je venais », confie-t-il aujourd’hui. Devenu avocat, Macodou Ndiaye vit désormais à Dakar avec sa femme et certains de ses nombreux enfants, dans un appartement confortable du quartier des Maristes. Dans le salon, au milieu de la pièce, trône la photo de cette mère qu’il n’a jamais connue, et dont il a donné le nom à sa première fille.
Transmission générationnelle
L’histoire si particulière de Macodou Ndiaye s’inscrit en vérité dans une histoire plus vaste, et largement méconnue. Comme son père, près de 60 000 tirailleurs sénégalais sont partis combattre pour la France en Indochine de 1945 à 1954. Près de 27 000 n’en reviendront pas. Parmi les combattants de retour dans leur pays après la défaite française, certains ne rentreront pas seuls : on estime à plus de 300 le nombre de femmes vietnamiennes qui ont quitté leur pays après la victoire d’Hô Chi Minh. Par amour, pour leurs enfants, pour leur propre sécurité également : considérées comme des traîtres pour avoir pactisé avec l’ennemi, elles étaient en danger dans leur propre pays.
Ces Vietnamiennes du Sénégal, quasiment toutes disparues aujourd’hui, sont souvent le moteur de l’ascension sociale de leur famille. Très vite, elles s’adaptent à leur nouveau pays, s’installent au marché Kermel de Dakar et popularisent la consommation de nems dans le pays en ouvrant des restaurants vietnamiens dans la capitale… Ciment de cette communauté mixte, elles ont laissé derrière elles des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants qui souhaitent perpétuer leur mémoire.
« L’histoire de ma grand-mère a toujours été un sujet tabou, raconte aujourd’hui Merry Bey Diouf, petite-fille de l’une de ses femmes. Lorsque, enfant, je lui posais des questions, elle se renfermait sur elle-même et me disait qu’elle avait oublié. Cela a aiguisé ma curiosité et c’est devenu une obsession. » Elle se remémore aujourd’hui les longs cheveux noirs de sa grand-mère, si différents des siens, qu’elle aimait tant peigner. Elle se souvient aussi des journées que son aïeule organisait avec ses amies vietnamiennes. Des fêtes d’où les enfants étaient exclus et où tout, nourriture, tenues, langue, leur rappelait leur pays perdu. Au fil des années, Merry Bey Diouf réussira à « arracher » des bribes d’informations à sa grand-mère. Elle rêverait aujourd’hui de retrouver sa grand-tante. « Au Sénégal, c’est une fierté de connaître sa famille, de pouvoir citer les noms de nos ancêtres. Je voulais être capable de faire la même chose pour mon côté vietnamien, que mes enfants sachent d’où ils viennent. »
Dialogues remémorés ou imaginés
Merry Bey Diouf, comme Macodou Ndiaye, collaborent depuis 2019 avec le vidéaste vietnamien Tuan Andrew Nguyen dans le cadre de son projet Specter of ancestors becoming [Le spectre des ancêtres en devenir]. L’exposition est présentée pour la première fois au Sénégal au centre d’art Raw Material Company à l’occasion de la Biennale de Dakar. Dans une petite pièce rectangulaire, quatre écrans se font face et diffusent simultanément des angles de vue différents de la même histoire. Trois descendants de tirailleurs y racontent une scène qu’ils ont vécue ou imaginée, sur le parcours de leurs ancêtres.
Macodou Ndiaye y tient ainsi le dialogue qu’il n’a jamais eu avec son père à propos de sa mère ; Merry Bey Diouf converse avec sa grand-mère. Le spectateur peut choisir de ne regarder qu’un écran à la fois, de se retourner constamment pour observer les différentes images, ou de se placer dans un coin de la pièce pour avoir la vue la plus large possible du film, sans jamais parvenir à tout percevoir en même temps. Un procédé à la fois perturbant et fascinant sur la façon dont fonctionne la mémoire.
« C’est le spectateur qui construit son propre film, selon le lieu où il se place et l’endroit où il décide de poser son regard, explique Tuan Andrew Nguyen. Ainsi, il est presque impossible de regarder le même film deux fois, car l’œil ne peut suivre qu’une image en même temps. J’imagine que c’est ainsi que fonctionne la mémoire : par fragments.» Au-delà de la question de la mémoire familiale et personnelle, c’est le sujet de la mémoire collective que l’artiste et ses collaborateurs explorent. « La mémoire dominante est celle que nous comprenons comme l’Histoire officielle, développe le vidéaste. Mais cette histoire officielle est incomplète, car le discours du vainqueur consiste aussi à raturer les autres mémoires. Celles des colonisés, des peuples du Sud, des gens de couleur, plus généralement. Ce sont nos histoires personnelles qui nous permettent de faire l’expérience de l’Histoire », ajoute-t-il.
L’art, outil de réparation
Né au Vietnam en 1976, l’artiste est arrivé aux États-Unis peu après sa naissance, avec des centaines de milliers de boat people. De retour dans son pays natal après ses études, Tuan Andrew Nguyen travaille sur les dynamiques de solidarité au sein des communautés du Sud. Il s’intéresse notamment aux combattants des colonies qui ont rejoint le Vietminh, se penche sur l’histoire des tirailleurs valorisés par la France pour leur habileté au combat mais dénigrés pour leur couleur de peau. « Je ne suis français que quand ils ont besoin de corps pour arrêter les balles. Le reste du temps, je suis noir », dit l’un des personnages du film.
Son travail est aussi celui d’une réflexion autour de l’impact de l’entreprise coloniale sur nos sociétés, et la façon dont les artistes peuvent réfléchir à des « modèles de décolonialité » selon les mots de la fondatrice du centre Raw, Koyo Kouoh. Le film, né des rencontres avec la communauté sénégalo-vietnamienne à Dakar, a été produit par ce centre dont l’objectif est de « créer des ponts entre la pratique artistique et la transmission de savoirs », explique sa directrice des programmes Marie-Hélène Pereira.
« Nous sommes allées à la rencontre de ces histoires que l’on n’enseigne pas à l’école. Entre l’histoire officielle et les histoires personnelles, il y a un écart énorme qui n’est pas rempli. L’art peut être un outil pour réfléchir à ce qui n’a pas été dit, pour combler ces silences », explique-t-elle. Merry Bey Diouf parle quant à elle d’une « cure » pour réparer des « blessures ouvertes » sur lesquelles pesait une chape de non-dits.
Dans le prolongement du projet de Tuan Andrew Nguyen, le centre Raw s’attelle à la collecte des archives (photos, documents) de ces familles, pour perpétuer la transmission de leur(s) histoire(s). « Cette communauté n’est pas arrivée ici par hasard, rappelle la productrice Fatima Sy. Il est important que les Sénégalais sachent pourquoi ». « On parle beaucoup de réparations pour les crimes de la colonisation, souligne Marie-Hélène Pereira. Pour nous, créer un espace pour que les personnes puissent raconter leur histoire, c’est une forme de réparation en soi. Une réparation que l’on peut faire entre nous. » (Jeune Afrique)