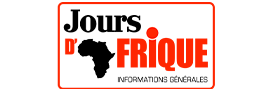L’Afrique est entrée en compétition avec « Lingui, les liens sacrés » de Mahamat-Saleh Haroun, un film qui aborde avec force le tabou de l’avortement.
L’Afrique est entrée en compétition avec le film Lingui, les liens sacrés de Mahamat-Saleh Haroun, qui avait reçu le Prix du jury à Cannes en 2010 pour Un homme qui crie. Le film aborde le tabou de l’avortement à travers le destin d’une adolescente enceinte à N’Djamena. Il est l’un des deux films du continent (sur 24 au total) en lice pour la Palme d’or, aux côtés de Hauts et fort du Marocain Nabil Ayouch. Applaudi de longues minutes à l’issue de la projection, le réalisateur n’a pas pu cacher son émotion, aux côtés de ses actrices.
Des femmes en lutte
Parce que Lingui est avant tout une histoire de femmes. Dans l’arabe-tchadien, le « lingui » désigne le système de liens d’entraide censé structurer vertueusement les rapports familiaux, amicaux et de voisinage. Le film s’emploie à en dénoncer les effets pervers. Filmé dans les faubourgs de la capitale tchadienne N’Djamena, le film raconte l’histoire d’Amina, mère seule, qui découvre que sa fille de 15 ans, Maria, est enceinte. Une grossesse, fruit d’un viol, que l’adolescente ne veut pas, dans un pays où l’avortement est condamné par la religion, mais aussi par la loi.
Seules, marginalisées, surveillées, le film dresse un portrait fort de femmes qui tentent de survivre dans un milieu hostile où patriarcat et religion empoisonnent la vie des femmes. Seule lumière d’espoir, « le lingui », lien qu’elles vont tisser entre elles pour tenter de s’en sortir. Comme lorsque Amina fait le choix de soutenir sa fille dans sa quête pour avorter, allant à l’encontre de sa foi.
Pour son réalisateur, le film ne traite pas seulement de la question de l’avortement mais du « quotidien des femmes » au Tchad. « C’est un film sur les héroïnes du quotidien (…) Ce sont elles qui portent le monde qui les maintient dans une forme de domination. Parler des femmes c’est forcément parler de tous ces problèmes », souligne-t-il.
Le spectateur sent le regard bienveillant du réalisateur sur ces personnages en quête d’émancipation, à l’heure où le cinéma s’interroge sur le regard masculin dans les films (male gaze). « En tant qu’homme, je fais partie du patriarcat, mais on arrive toujours en tant qu’individus en conscience à se débarrasser de tout ce qu’on a eu en héritage. Il faut croire en cette possibilité que l’homme puisse changer », assure-t-il.
Un film dépouillé, qui réussit le pari de transporter le spectateur dans la réalité de N’Djamena. « J’ai grandi dans le dépouillement, pour moi c’est important d’aller à l’essentiel », détaille-t-il.
L’Afrique toujours sous représentée
Dans l’histoire du festival, un seul réalisateur issu du continent africain s’est vu décerner la distinction suprême : l’Algérien Mohammed Lakhdar-Hamina en 1975 avec « Chronique des années de braise ». « Je me souviens de la première fois où je suis arrivé à Cannes. J’étais au dernier rang là-haut et je me disais que ce serait bien que je sois en bas quand même. Et à chaque fois que je me retrouve ici, je me dis naïvement, mais si j’aime croire en cette idée, qu’il y a un jeune ou une jeune assis au dernier rang qui se dit qu’un jour il descendra ici, et ça, ça me galvanise », a lancé Mahamat Saleh Harou au public.
Conscient d’être le seul représentant de l’Afrique subsaharienne, Mahamat Saleh Haroun assume d’en être une de ses voix, sans pour autant vouloir être réduit au rang de porte-parole de cette région : « Je ne suis qu’un vent qui passe, mais pour que la vie continue il faut aussi d’autres vents, des bourrasques », plaisante-t-il lors d’un entretien à l’AFP. « On essaye modestement de faire avancer les choses. En filmant au Sahel, j’ai aussi conscience que c’est un lieu où je peux produire des images positives dans un endroit où la vie est un cauchemar permanent », souligne celui qui a été un temps ministre de la Culture et du Tourisme de son pays. (lepoint.fr)