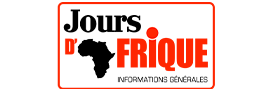Le temps qui passe n’y change rien : Murambi a beau être entouré de douces collines d’un vert phosphorescent, comme tant d’autres localités du Rwanda, une tristesse infinie, presque oppressante, recouvre ici la beauté du paysage. Comme si, près de trente ans plus tard, les lieux restaient hantés par les fantômes du génocide des Tutsis, qui a endeuillé ce petit pays de l’Afrique des Grands Lacs en 1994.
D’ailleurs ils sont bien là, les morts. On peut les voir dans les salles de classe de l’ancienne école technique reconvertie en mémorial : des corps blanchis à la chaux, tordus, tourmentés. Immortalisés dans leur dernière agonie. Dès l’entrée, des stèles noires énumèrent les noms des innombrables victimes de l’attaque du 21 avril 1994. En réalité, ce sont les autorités qui avaient ordonné aux Tutsis, systématiquement traqués à partir du 7 avril, de se regrouper sur ce site. Officiellement pour «assurer leur sécurité». Ici comme ailleurs, ce fut un piège fatal. Plus tard, on déterrera plus de 20 000 corps. Mais certains évoquent le chiffre de 50 000 victimes, massacrées en quelques heures ce jour-là.
Au sud-ouest du pays, la préfecture de Gikongoro, où se trouve Murambi, fut l’une des plus touchées par le génocide. Et le «travail», comme on disait à l’époque, fut achevé en quelques semaines. Ce même 21 avril, une fois Murambi transformé en charnier à ciel ouvert, les militaires et les miliciens, ou de simples paysans abreuvés de propagande raciste, iront massacrer dans la foulée les Tutsis toujours présents sur deux autres sites, à Cyanika et à Kaduha. Encore plusieurs dizaines de milliers de morts supplémentaires. Il ne reste aujourd’hui qu’une poignée de survivants.
Un homme taiseux
Ces prochaines semaines, certains feront le voyage jusqu’en France. Pour être confrontés à l’homme le plus puissant de la province à cette époque : l’ex-préfet Laurent Bucyibaruta, dont le procès aux assises s’ouvre ce lundi à Paris. Il devrait durer plus de deux mois, jusqu’au 12 juillet. Mis en accusation pour six infractions, dont la participation au génocide, aujourd’hui âgé de 78 ans, Bucyibaruta a quitté le Rwanda en juillet 1994, quand les forces génocidaires ont fini par être boutées hors du pays par une rébellion tutsie, le Front patriotique rwandais (FPR). Après quelques années d’errance, il atterrit en France, s’installe avec sa famille, à Saint-André-les-Vergers, paisible bourgade de la banlieue de Troyes, dans l’Aube. C’est un vieux monsieur désormais, malade et affaibli, avec de grosses lunettes.
«Comme dans les films, on voudrait tant que les criminels aient le visage de leurs actes : de sales gueules transpirant la cruauté et le sadisme. Mais les procès révèlent des réalités différentes, bien plus complexes», écrit l’ancien juge belge Damien Vandermeersch, l’un des premiers à s’être confronté à ce génocide, dans un petit ouvrage publié en 2013 et intitulé Comment devient-on génocidaire ? Et si nous étions tous capables de massacrer nos voisins. Depuis Hannah Arendt et le procès Eichmann, «bourreau ordinaire» de la Shoah, la question reste intacte, vertigineuse.
Avant 1994, Bucyibaruta ne semble pas s’être fait remarquer par des propos extrémistes contre les Tutsis, pourtant régulièrement stigmatisés depuis l’indépendance et la prise du pouvoir par les représentants de la majorité hutue. Il avait la réputation d’être plutôt taiseux. Les psychiatres qui l’ont examiné avant le procès notent qu’il semble même «dépourvu de toute fibre émotionnelle». Il était membre de l’ancien parti unique, toujours au pouvoir à la veille du génocide. Il a épousé une Tutsie, comme d’ailleurs beaucoup de notables hutus de l’époque.
«Les massacres ont un caractère organisé»
Est-ce pour préserver la vie de sa femme et de sa belle-famille qu’il n’a opposé que peu, voire pas, de résistance aux gigantesques tueries qui ont eu lieu dans sa préfecture ? Au lendemain du massacre de Murambi, il affirme ne pas avoir jugé nécessaire de se rendre sur place. Devant les enquêteurs, il déclare souvent avoir été «dépassé», voire «paniqué», par l’ampleur de cette orgie de sang. Elle semble pourtant avoir été bien encadrée, dans un pays depuis longtemps quadrillé par une administration pyramidale très hiérarchisée, au sein de laquelle le préfet était tout-puissant. «Quand le Rwanda entame sa descente aux enfers, ce n’est pas le chaos à tous les étages. Les massacres ont un caractère organisé, même systématique», rappelle ainsi Damien Vandermeersch.
Et certains des témoins convoqués par la justice française, accusent l’ancien préfet d’avoir eu un rôle actif dans l’organisation des massacres. Rencontrés par Libération en mars 2021, à Murambi, dans l’antre des morts qui eux ne parleront plus, deux témoins du carnage du 21 avril 1994, sont formels : Bucyibaruta n’est pas un haut fonctionnaire frileux, ignorant ou écrasé par la virulence menaçante de certains de ses subordonnés, dont le rôle accablant sera évoqué pendant le procès.
«Le préfet est passé plusieurs fois par la barrière de Kabuza, dressée dès le 8 avril non loin de l’école technique de Murambi. Je m’y trouvais ! Le préfet nous encourageait à bien travailler. On savait tous ce que ça voulait dire», affirmait ainsi d’une voix éraillée, il y a un an, Emmanuel Niyilinbuga simple cultivateur enrôlé dans les massacres. Ce qui lui vaudra une peine de sept ans de prison. Petit bonhomme au visage chiffonné, aujourd’hui âgé de 61 ans, il a également participé à l’attaque du 21 avril à Murambi. Il soutient que Bucyibaruta était là, juste avant l’assaut déclenché à 3 heures du matin.
«Nous avons tenté de résister en leur lançant des pierres. Mais vers six heures du matin, c’était perdu. Ils étaient trop nombreux. Il y avait des gendarmes avec des fusils et des grenades», raconte de son côté Simon Mutangana, un Tutsi laissé pour mort, enfoui sous les cadavres. «De là où j’étais, j’ai vu Bucyibaruta, arrivé sur place le matin. Il a ordonné aux miliciens d’aller attaquer dans la foulée la paroisse de Cyanika», accuse-t-il. Emmanuel et Simon seront entendus lors du procès. Confrontés à l’accusé, mais aussi à d’autres témoignages qui vont certifier que le préfet a fait ce qu’il a pu, dans une situation extrême.
Le poids du temps
Langage codé, parole contre parole, distance culturelle et géographique : le procès de Laurent Bucyibaruta n’échappera pas aux obstacles qui ont déjà émaillé ceux des quatre Rwandais déjà jugés en France pour crimes de génocide, et tous condamnés. Sans oublier le poids du temps qui passe et altère les souvenirs du déroulé précis des faits. Pourquoi cet homme, qui ne s’est jamais soustrait à la justice française, comme le soulignent ses avocats, est-il jugé si tardivement ?
Les premières plaintes contre lui remontent à plus de vingt ans. Déposées en 2000 par l’association Survie et la Fédération internationale pour les droits humains. D’autres se constitueront très vite parties civiles. Dont le Collectif des parties civiles pour le Rwanda, la Ligue des droits de l’homme, la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme, l’association Ibuka des rescapés du génocide ou la Communauté rwandaise de France. Tous seront représentés au procès par une armada d’avocats, impatients de voir enfin aboutir cette enquête judiciaire, ouverte plus de deux décennies auparavant. D’autant plus laborieuse qu’elle avait été pourtant renforcée par les accusations du Tribunal pénal international pour le Rwanda mis en place fin 1994 en Tanzanie pour juger les principaux responsables du génocide, et qui avait inculpé Laurent Bucyibaruta dès 2005. Avant de se dessaisir au profit de la justice française en 2007.
Les avocats de l’accusé souhaiteraient même prendre prétexte de la durée «déraisonnable» de la procédure pour demander son annulation, écartant le caractère imprescriptible des crimes. Encore aurait-il fallu doter les juges de plus de moyens. Leur permettre d’échapper aux blocages politiques qui ont envenimé les relations entre la France et le Rwanda après la fin du génocide. Paris s’étant trop longtemps fourvoyé aux côtés du régime qui va conduire à la solution finale, comme l’a enfin reconnu il y a un an, la commission Duclert, mandatée par Emmanuel Macron et chargée d’examiner les archives françaises sur cette période trouble.
C’est d’ailleurs grâce à l’intervention militaire française déclenchée fin juin 1994 que Laurent Bucyibaruta va pouvoir fuir son pays. Sous couvert d’humanitaire, elle permettra un temps de sanctuariser le sud-ouest du Rwanda, quand les forces génocidaires, anciens alliés de la France, amorcent leur retrait. L’opération Turquoise installera un QG à Gikongoro. Les militaires français camperont dans l’école technique de Murambi et auraient joué au volley juste à côté d’une des fosses communes du massacre d’avril. Ils y sont aussi accusés d’avoir violé des rescapées tutsies. Pendant cette période, Bucyibaruta sera leur interlocuteur privilégié. A priori, ce chapitre final du génocide ne figure pas au cœur du procès qui s’ouvre lundi. Il sera cependant abordé lorsque sera évoqué le supposé refus du préfet de délivrer des papiers d’identité à une jeune infirmière, protégée par les militaires français. Au simple motif qu’elle aurait été tutsie.
Le choix face au péril, une décision intime
Mais pour l’essentiel, c’est son rôle dans les premières semaines du génocide qui sera examiné. Jamais il ne se dissocie du régime génocidaire. Le 29 avril, une semaine après les massacres de Murambi, Cyanika et Kaduha, le Premier ministre de ce gouvernement de nazis tropicaux, lui rend visite. Et se dit «fier de la préfecture de Gikongoro puisqu’elle s’est appliquée à mettre en place le programme du gouvernement». D’autres préfets ont refusé d’appliquer la solution finale. Ils ont été tués ou ont dû s’enfuir. Pour tous, le choix face au péril fut une décision intime.
Le 7 mai, les élèves tutsis du collège de Marie-Merci à Kibeho sont exterminés, trois jours après la visite de Bucyibaruta sur place. Ils étaient déjà menacés, mais on raconte que les élèves hutus ont eux-mêmes dénoncé leurs camarades tutsis, bientôt livrés aux tueurs. A quel moment devient-on effectivement génocidaire ? Quels réflexes, quelles grilles de lecture intériorisées, ressurgissent quand il s’agit de faire un choix face au mal absolu ? En décembre 1963, Bucyibaruta n’avait que 19 ans quand le philosophe Bertrand Russell dénonçait dans la presse internationale «le pire massacre depuis l’extermination des Juifs», en évoquant l’un des premiers pogroms contre les Tutsis à Gikongoro.
Laurent Bucyibaruta a grandi dans cette région, dans ce pays-là. Celui des tueries récurrentes ciblant les Tutsis. Celui de l’impunité. En avril 1994, elle semblait assurée pour le camp des génocidaires. Car rien ne prédisait encore qu’ils allaient bientôt devoir renoncer, fuir hors du pays. Et personne n’aurait alors pu imaginer que les cadavres suppliciés de Murambi seraient un jour exposés aux yeux de tous. Comme une accusation muette, qui défie le temps des procès. (Libération)