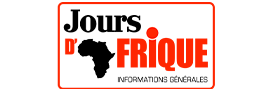Dix personnes, dont un prêtre originaire d’Ille-et-Vilaine et une religieuse de Mayenne, ont été kidnappées ce week-end dans ce pays gangrené par la corruption et l’instabilité politique.
Le pays vit sous la coupe de gangs armés depuis une trentaine d’années, mais le phénomène de rapts a pris de l’ampleur ces derniers mois, observe le juriste et politologue Éric Sauray, originaire d’Haïti. Dimanche matin, dix personnes, dont deux Français, ont encore été enlevées à la Croix-des-Bouquets, près de Port-au-Prince. Les ravisseurs ont exigé une rançon d’un million de dollars.
La veille au soir, c’est un médecin et un expert-comptable qui disparaissaient à Delmas 75, à l’ouest de la capitale. Le 1er avril, quatre personnes dont un pasteur étaient kidnappées en plein service religieux par des hommes lourdement armés, qui ont diffusé l’attaque en direct sur le Net…
Qui est derrière cet enlèvement ?
Le rapt de dimanche est attribué au groupe 400 Mawozo. Dans ses rangs figurent d’anciens policiers – voire des agents en service – et des militants ou ex-militants politiques, liés à des élus ou aux détenteurs symboliques du pouvoir politique et culturel, affirme Éric Sauray.
Ce gang est spécialisé dans l’enlèvement, le détournement de camions de marchandises, l’assassinat et le viol, énumérait en décembre le porte-parole de la police, Gary Desrosiers. On lui attribue notamment le kidnapping, en décembre, d’une quinzaine d’écoliers (libérés depuis) ; le meurtre de la jeune Shella Jean-Claude qui avait secoué le pays en janvier 2019 ; ou encore l’assassinat d’un chauffeur de l’ambassade du Chili, lors de l’attaque d’une délégation en 2017.
Un gang parmi d’autres ?
Une centaine de bandes armées sévissent à Haïti. Comme le « 400 Mawozo, elles vivent de trafics, vols de voitures et enlèvements. Riches ou pauvres, Haïtiens ou étrangers, personne ne semble à l’abri.
Des connivences politiques ?
L’argent des rançons arrive bien quelque part, pointe Éric Sauray : « Impossible d’imaginer, dans un si petit pays (11,5 millions d’habitants), que les autorités ne puissent pas démanteler ces gangs, si elles le voulaient vraiment. Pour lui, aucun doute : Chaque camp, le pouvoir comme l’opposition, dispose de ses propres gangs. Et tous les présidents, sans exception, ont participé à l’affaiblissement de l’État en s’appuyant sur ces bandes, d’une manière ou d’une autre. Difficile de se passer du soutien de ceux qui font la loi dans des quartiers entiers.
Le Président sur la sellette ?
La politique sécuritaire de Jovenel Moïse est un fiasco. En attestent ces rapts, mais aussi la spectaculaire évasion de 400 détenus, en février, d’une prison de Port-au-Prince : la moitié des fuyards court toujours.
Sa déroute est aussi économique. Depuis un an, l’inflation galope, l’essence manque et le pays a dévissé au 170e rang mondial sur 189, pour son indice de développement humain. Haïti ne s’est jamais vraiment remise du séisme de 2010 (200 000 morts et 1,5 million de sans-abris) et de l’épidémie de choléra qui a suivi (10 000 morts). L’ouragan Matthew de 2016 (500 morts et des dégâts considérables) n’a fait qu’empirer les choses.
Six Haïtiens sur dix vivent sous le seuil de pauvreté (2 € par jour). Seule satisfaction : ils sont relativement épargnés par le Covid-19 (250 décès officiellement). Mais leur pays ne dispose d’aucun vaccin…
Moïse s’accroche ?
Jovenel Moïse, 52 ans, ancien patron d’une société d’export de bananes, avait vu son élection annulée pour fraude, en 2015. Un an plus tard, il a gagné, mais la faible participation (21 %) n’a fait qu’attiser la colère populaire. S’en sont suivies des manifestations réprimées dans le sang ; la chute de son gouvernement en mars 2019 ; puis une enquête de la Cour des comptes pour détournement de fonds du programme de développement Petrocaribe, parrainé par le Venezuela…
Le chaos est tel que Jovenel Moïse ne parviendra jamais à organiser les législatives. Sans Parlement depuis janvier 2020, il gouverne à coups de décrets à la légalité douteuse. Et s’entête à vouloir organiser, en juin, un référendum constitutionnel qui lui permettra de… se représenter.
Une aubaine pour les gangs ?
Considérant que le mandat de Jovenel a débuté dès 2015, l’opposition ne le reconnaît plus comme président depuis février 2021. Elle a même désigné un dirigeant de transition, le haut magistrat Joseph Mécène Jean-Louis. Haïti compte donc… deux présidents. Et une société plus divisée que jamais. Pour Éric Sauray, cela ne fait que favoriser l’émergence de groupes violents capables de mettre l’État à distance. (Ouest France)