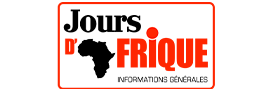Le mot « dette » est devenu un fouet que l’on brandit au-dessus des pays africains pour susciter peur et soumission. Mais cela ne peut plus être une conversation à sens unique, et le continent ne se laissera pas décourager par les insultes, le dénigrement, les récits mensongers ou les tweets malveillants, insiste le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa.
Le 30 juin, je me suis rendu à Washington pour des réunions au département d’État américain. L’objectif principal de cette visite était de discuter des relations bilatérales entre le Ghana et les États-Unis, notamment à la lumière des préoccupations récentes concernant la sécurité régionale, les engagements financiers et les éventuelles restrictions de visas.
J’étais accompagné de notre ambassadrice par intérim aux États-Unis, Jane Gasu, de Ramses Cleland, le directeur général du ministère des Affaires étrangères, ainsi que de plusieurs conseillers de haut niveau. Nous avons rencontré la sous-secrétaire d’État aux affaires politiques, Allison Hooker, avec qui j’ai eu un échange franc et positif, ainsi que l’ambassadeur Troy Fitrell, haut responsable du bureau des Affaires africaines, qui nous a accueillis chaleureusement.
Des attaques ad hominem
Il nous a été expliqué que la raison pour laquelle le Ghana figurait parmi les pays susceptibles de faire l’objet d’une interdiction de visas est que le taux de dépassement de séjour des visas étudiants est de 21 %, alors que le seuil maximum autorisé par les États-Unis est de 15 %.
Nous avons quitté Washington avec des perspectives prometteuses. De plus, nous étions convaincus que toutes nos rencontres avaient été extrêmement productives, un sentiment confirmé par les tweets d’Allison Hooker et du bureau des Affaires africaines.
Imaginez donc ma surprise en apprenant qu’en réponse à ces deux tweets, le sénateur Jim Risch, président de la commission des Affaires étrangères du Sénat, a publié un message qui équivalait à une attaque ad hominem. Il affirmait que, plutôt que de me rendre à Washington, j’aurais dû rester au Ghana pour m’occuper du remboursement de la dette ghanéenne envers les États-Unis.
Historiquement, les États-Unis et le Ghana ont toujours entretenu un partenariat respectueux. Notre premier président, le Dr Kwame Nkrumah, a étudié à la Lincoln University et à l’Université de Pennsylvanie.
Parmi les citoyens américains les plus éminents (dont deux lauréats du Prix Nobel de la paix, Ralph Bunche et Martin Luther King, ainsi que le vice-président Richard Nixon), nombreux sont ceux qui étaient présents au Ghana à l’heure de notre indépendance. J’ajouterais que le Dr W.E.B. DuBois, premier Noir à obtenir un doctorat à Harvard (et le deuxième aux États-Unis), a choisi le Ghana comme dernière demeure et y repose aujourd’hui.
« Le Ghana a toujours été un allié fiable des États-Unis »
Dans notre région, le Ghana a toujours été un allié fiable des États-Unis : nous avons un solide accord de coopération en matière de défense ; nous avons mis en œuvre des projets phares dans le cadre du Millennium Challenge Corporation ; depuis la découverte du pétrole et du gaz commercialisables en 2010, de nombreuses entreprises américaines se sont installées au Ghana ; nous sommes partenaires de l’African Growth and Opportunity Act (Agoa), qui favorise le commerce et les investissements entre les États-Unis et les pays africains.
En outre, lorsque les États-Unis ont traversé des périodes difficiles – comme en 2016, lorsqu’ils cherchaient des partenaires pour accueillir d’anciens détenus de Guantanamo Bay –, le Ghana est resté un ami fidèle. Nous n’avons pas rejeté la demande américaine, bien que cette décision ait été accueillie avec tiédeur par l’opinion publique ghanéenne.
Peut-être que dans d’autres pays, la curiosité de voyager et le désir de s’expatrier vont dans un seul sens. Mais entre les États-Unis et le Ghana, cela fonctionne dans les deux sens. L’an dernier, le Ghana a délivré plus de 80 000 visas à des citoyens américains pour le tourisme et les affaires. Aujourd’hui, environ 10 000 Américains résident au Ghana comme expatriés, et ce chiffre est en nette hausse.
Ce partenariat entre nos deux nations a traversé de nombreuses administrations, résisté aux bouleversements mondiaux (des récessions économiques aux conflits régionaux) et au passage du temps. C’est un signe d’endurance et de loyauté mutuelle.
Le tweet du sénateur Risch n’était pas seulement décevant, il était également trompeur. Si l’absence de dette était une condition préalable pour voyager, bien peu de personnes de n’importe quelle nationalité pourraient se déplacer, que ce soit pour des raisons personnelles, professionnelles ou politiques.
Chaque gouvernement hérite de la dette de son prédécesseur. Ce fut le cas en janvier dernier aux États-Unis comme au Ghana, lorsque les nouveaux présidents ont été investis. Je ne peux, pour ma part, parler que des efforts du Ghana pour sa relance économique sous la nouvelle administration Mahama. Nous avons renforcé notre monnaie, à tel point que, deux mois consécutifs, le cedi a été désigné comme la devise la plus performante au monde. Nous avons aussi lancé un programme de restructuration de la dette.
Lorsque le président Donald Trump a annulé les fonds alloués par l’Usaid à plus de 5 000 projets d’aide étrangère, le Ghana a été directement affecté. Nous devons désormais trouver 156 millions de dollars pour compenser ce manque à gagner, une perte qui, malgré tous nos efforts, entraînera des pertes de vies humaines.
« En avant toujours, en arrière jamais »
J’ai répondu au sénateur Risch par un tweet lui rappelant que le Ghana est une nation souveraine et que les États-Unis ont, eux aussi, une dette envers le Ghana. Une dette que nos deux pays n’ont pas encore vraiment évoquée.
Lorsque les nations africaines évoquent la dette qui leur est due à cause de l’esclavage et du colonialisme, c’est perçu comme un acte de défi. En réalité, c’est un acte de détermination. C’est cette détermination, en l’absence de justice réparatrice, qui nous a permis de survivre et de continuer à progresser.
Le Ghana est un pays relativement jeune : nous avons eu 68 ans en mars. Si nous comparions notre situation actuelle à celle des pays du « Nord global » au même âge, et que nous prenions en compte leur dépendance aux ressources naturelles africaines et à la main-d’œuvre asservie durant leur développement, nous verrions l’ampleur de leur dette envers nous. Nous verrions aussi jusqu’où notre ingéniosité, notre engagement humanitaire et notre détermination nous ont menés.
Le Ghana ne se laissera pas décourager par les insultes, le dénigrement, les récits mensongers ou les tweets malveillants. Nous continuerons d’avancer, selon les mots de Kwame Nkrumah : « En avant toujours, en arrière jamais », dans notre quête de leadership pour permettre à chaque Ghanéen d’atteindre son plein potentiel et pour coopérer avec nos partenaires partout dans le monde.
Ces principes – notre foi dans un ordre fondé sur des règles, la charte de l’ONU, le panafricanisme et le multilatéralisme – continueront de guider la politique étrangère du Ghana. En ces temps volatils et incertains, alors que la loyauté et la confiance sont rares dans les relations internationales, le Ghana entend rester un pilier de stabilité et de fiabilité. Nous comptons rester fidèles à notre politique étrangère de « neutralité positive », chère à Nkrumah.
Nous sommes résolus à rester un des principaux contributeurs aux missions de maintien de la paix de l’ONU, et à continuer de montrer l’exemple en tant que pays le plus pacifique d’Afrique de l’Ouest. Nous sommes résolus à demeurer un modèle de dignité noire, d’émancipation et d’excellence. Mais par-dessus tout, nous sommes déterminés à poursuivre le dialogue sur les mesures réparatrices qui permettront à l’Afrique de continuer à s’élever.