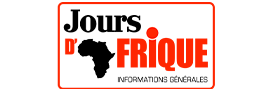ENTRETIEN. Le plaidoyer de Cheikh Gueye, coauteur du Rapport alternatif sur l’Afrique, pour repenser le développement et l’articuler à la souveraineté populaire.
Les bases du Rasa (Rapport alternatif sur l’Afrique) avaient été jetées en mai 2018. La multitude d’auteurs impliqués dans ce projet continental, issus de think tank, d’instituts de recherches ou d’ONG, convergeaient alors sur un principe directeur pour repenser les défis de l’Afrique et en particulier ses orientations de politiques économiques : la souveraineté. Et à celle « qui met l’accent sur la souveraineté nationale », ils préféraient la notion de « souveraineté populaire qui permet une compréhension plus poussée des mécaniques réelles à la base des transformations sociales. » La crise sanitaire, révélatrice des vulnérabilités des pays africains face aux bouleversements du commerce mondial, « nous a donné raison », estime aujourd’hui Cheikh Gueye, coordinateur stratégique de la plateforme stratégique d’Enda Tiers Monde et secrétaire permanent du Rasa. Il revient pour Le Point Afrique sur la vision qui infuse les sept grands axes de ce premier numéro du Rapport alternatif sur l’Afrique intitulé : « La recette pour la souveraineté africaine ».
Le Point Afrique : Ce rapport se veut différent de ceux qui sont régulièrement produits sur l’Afrique, notamment par les institutions financières internationales. Qu’est-ce qui change concrètement ?
Cheikh Gueye : À la différence des rapports initiés par ces institutions, mais aussi certaines banques ou grandes ONG implantées dans des pays du Nord, notre étude a été produite par des institutions africaines qui se sont toujours clairement positionnées sur la récupération de la souveraineté intellectuelle ou la sortie de la bibliothèque coloniale. Ce rapport met également en avant les questions qui concernent les sociétés africaines, et pas seulement les États et les marchés, qui sont souvent les prismes d’analyse des institutions internationales.
Nous partons des réalités sociales, des pouvoirs infra-étatiques, des innovations, des cultures… La culture étant un domaine occulté dans les rapports habituels alors qu’elle est centrale à nos yeux : elle détermine les changements des modes de consommation et de production des Africains. Nous cherchons aussi à créer de nouvelles ouvertures dans la réflexion sur le développement économique, à rebours de la tendance au développement basée sur l’individualisme, l’extractivisme effréné, la compétition, car cela a contribué à l’appauvrissement de pans entiers du globe et à la dégradation de l’environnement. Il y a des tentatives de résistances des sociétés africaines, mais là encore, ces éléments ne sont pas rapportés dans les rapports « classiques ».
Quels types d’indicateurs alternatifs sont préconisés dans ce rapport ?
Les notions de bien-être ou de progrès ne peuvent pas être les mêmes pour tous les peuples ni pour toutes les catégories de personnes. L’économie néolibérale considère les individus et les populations sous l’angle exclusif du producteur ou du consommateur. La réflexion est désormais ouverte dans les institutions internationales et les auteurs du Rasa lancent le débat sur les indicateurs alternatifs aux agrégats classiques, en invitant à plus considérer les aspects socioculturels, les liens sociaux, les principes de l’économie sociale et solidaire, mais surtout la souveraineté, qui est notre baromètre principal. L’approche par les capacités théorisées par l’économiste et philosophe indien Amartya Sen est une des propositions, car elle peut faciliter la définition d’indicateurs plus conformes aux cosmogonies des Africains.
L’élaboration de ce rapport a commencé avant la pandémie de Covid-19. Comment ses idées et principes directeurs ont-ils été traversés par les effets de cette pandémie sur le continent africain ?
Durant la pandémie, le monde entier a été confronté à la question de souveraineté, qui est au cœur de notre rapport. Mais l’Afrique est peut-être le continent où cette question a été la plus agitée depuis quelques années. On y observe une régénérescence de la pensée souverainiste et indépendantiste des pères fondateurs comme Nkrumah, Modibo Keita ou encore Cheikh Anta Diop. Elle est aujourd’hui portée par de nouvelles générations, à travers le débat sur la pensée décoloniale, ou bien des événements comme Les ateliers de la pensée initiés par les universitaires Achille Mbembé et Felwine Sarr.
Le Covid-19 nous a donné raison sur le choix de cet angle d’attaque. On a vite compris qu’en Afrique, l’impact de la pandémie serait moins important sur le plan sanitaire et très important sur le plan économique. Nos économies obéissent au libre-échangisme, qui est le fait dominant de la doxa néo-libérale et de la mondialisation. Or cette crise n’a fait que confirmer que nous représentons trop peu dans ce libre-échangisme pour continuer à y participer et à essayer d’y trouver notre intérêt. Ce constat a été établi très tôt, quand de nombreux secteurs ont commencé à ralentir. Les ports ont été à l’arrêt, les importations de biens et de services, comme le tourisme, ont été interrompues… Et nos banques centrales n’avaient pas la possibilité comme dans les autres pays de générer des liquidités.
Cette crise sanitaire a-t-elle de fait rendu plus prégnante la question de la « déconnexion » que vous prônez, à l’instar de l’économiste Samir Amin, et quel sens lui donnez-vous ?
Nous nous attendions à une sorte de révolution copernicienne, à un choc thérapeutique de nature à changer les mentalités. Mais depuis que des solutions au Covid-19 ont été trouvées, avec les vaccins, la révolution n’est plus une option. Il n’en demeure pas moins que l’Afrique doit se réinventer sur la base d’une nouvelle souveraineté et d’une déconnexion du système international dans lequel nous ne serons jamais gagnants. Nous y sommes infantilisés, subalternisés. Et puis, quels que soient les progrès que nos États puissent faire, cela n’aura pas d’impact significatif sur nos sociétés.
La déconnexion n’est pas une autarcie. C’est une stratégie en vue de définir nos politiques par nous-mêmes, de développer les gains de souveraineté sur les bases qui nous paraissent fondamentales. Comme l’agriculture, qui mène à la souveraineté alimentaire en développant des systèmes industriels tournés vers les besoins et les intérêts des Africains, et non vers l’exportation. Il s’agit aussi de souveraineté économique, en récupérant les ressources investies dans les chaînes de valeur mondiales, et monétaires. Et cela passe, bien sûr, par une accélération de l’intégration africaine.
L’agriculture a rarement été considérée comme un levier du développement économique par les bailleurs de fonds internationaux, alors qu’elle occupe une place importante dans les économies et les sociétés africaines. Comment expliquer ce décalage ?
Le secteur agricole n’a pas bénéficié de l’attention nécessaire. Il a longtemps été écarté dans les rapports internationaux auxquels les dirigeants africains sont attentifs. De fait, l’agriculture a été dévalorisée, « désinvestie ». Au début des années 1970, on parlait beaucoup de révolution agricole. Puis il y a eu la grande sécheresse au Sahel. On a alors compris que les pays africains devaient réinventer leur modèle agricole et réinvestir pour faire face aux chocs climatiques et à l’exode rural. Mais peu de temps après, la PAC (Politique agricole commune) a commencé à subventionner massivement l’agriculture au Nord, alors qu’en Afrique, où les plans d’ajustement structurels se mettaient en place, il n’était pas question de soutenir le secteur agricole.
Et ce dessaisissement de l’investissement ou des capacités d’investissement dans l’agriculture, c’est ce que nous payons aujourd’hui, y compris en matière de migration des jeunes Africains vers les villes, puis à travers l’Afrique ou hors du continent. Et l’Afrique n’a pas eu l’audace, ni les moyens, d’inverser à l’époque cette orientation donnée par les institutions internationales à nos économies. Même aujourd’hui, quand on parle d’agriculture, c’est sous l’angle de la libéralisation, de la disponibilité de nos terres pour des investisseurs internationaux, et non pas en termes de souveraineté alimentaire.
Que faudrait-il mettre en place pour favoriser la souveraineté alimentaire, une notion qui intègre la possibilité de mettre en œuvre ses propres systèmes agricoles et alimentaires ?
Le préalable selon nous est une réforme du foncier. Nous observons une tendance des investisseurs nationaux et internationaux à accaparer les terres, et cela menace le paysannat. Nous estimons qu’il faut récupérer ou limiter les aires cédées à des multinationales ou titrées au profit d’industriels appuyés par des États européens et asiatiques, pour développer l’agriculture familiale autour de systèmes de production agro-écologiques. Ces accaparements de terres évoluent très vite et concernent les terres les plus fertiles. Bien que nous ayons des législations nationales très différentes à travers le continent, la réforme du foncier nous paraît être une condition sine qua non pour atteindre la souveraineté alimentaire.
Y a-t-il des pays en Afrique qui favorisent ce type de réformes visant à sécuriser l’accès à la terre des agriculteurs ?
Une commission sur la réforme foncière a été mise en place au Sénégal en 2017, mais pour l’instant, l’État tergiverse. Cela paraît mieux engagé dans les pays anglophones est-africains, et en Afrique du Nord, où l’acquisition de terres par des acteurs privés étrangers est plus contrainte.
Vous avez évoqué le modèle de l’exploitation familiale. Ce type d’agriculture serait-il un modèle dominant selon votre vision, ou pourrait-il cohabiter avec l’agro-industrie ?
La souveraineté alimentaire passe par la capacité des paysans, qui représentent entre 40 et 70 % des populations dans nos pays, à s’organiser pour produire ce dont ils ont besoin, avant même de penser à exporter des surplus. Il s’agit donc d’investir massivement dans l’agriculture familiale. Mais quand on parle d’agriculture familiale, il ne s’agit plus de la petite exploitation autour de la case. Nombre d’agriculteurs cultivent aujourd’hui de grandes surfaces, et on voit aussi cette dynamique des nationaux qui retournent à la terre, poussés par la demande de consommer des produits locaux. La généralisation des coopératives pourrait aussi leur permettre de mieux s’organiser et de gagner en parts de marché pour augmenter les échanges de proximité. Naturellement, il n’est pas exclu que des investisseurs étrangers viennent se greffer à certains projets par la suite.
Comment garantir le juste prix au producteur, par quel mécanisme ?
L’agriculture ne peut fonctionner sans accompagnement de l’État, et cela ne vaut pas que pour l’Afrique. On ne peut pas laisser les paysans à la merci de spéculateurs ou des vicissitudes du marché international. Certes, il est plus difficile dans nos pays de mobiliser des fonds, en particulier dans les pays de la zone CFA, mais tout est question de priorité. Regardez comment nos pays ont fait ces derniers mois pour affronter le Covid-19 : ils ont emprunté, renoncé à certaines dépenses. Actuellement, hélas, les investissements dans l’agriculture restent très faibles, et les paysans sont livrés à eux-mêmes.
Au Sénégal, l’ex-président Abdoulaye Wade avait engagé en 2008 la Grande offensive agricole. Quelles sont les retombées ?
En effet, la souveraineté alimentaire a été érigée en objectif primordial, par les régimes du président Abdoulaye Wade et du président Macky Sall avec des investissements dans le cadre d’un programme accéléré visant à augmenter la production de riz, de mil, de légumes et de fruits. De nombreux produits ont connu des croissances significatives, donc les résultats sont là, même si les délais pour atteindre l’autosuffisance en riz ont été dépassés. Il va donc falloir maintenir ces investissements, qui se chiffrent à 60 milliards de francs CFA (environ 100 millions d’euros) par campagne agricole. Au-delà des incantations, c’est un montant encore trop faible pour espérer une véritable révolution agricole et un retour massif des jeunes vers l’agriculture. Si l’État le voulait, il pourrait investir beaucoup plus.
Vous dites dans ce rapport qu’il sera nécessaire à moyen terme de modifier les habitudes alimentaires. C’est-à-dire ?
Changer les habitudes alimentaires, c’est aussi une étape de la décolonisation du système économique. Une grande partie des systèmes de production ont été mis en place pour satisfaire les besoins des métropoles sous l’administration coloniale. Les cultures de rente ont donc été dominantes durant une centaine d’années au détriment des productions locales, et les États ont par la suite encouragé ce système qui permettait de générer des devises. Par ailleurs, nous sommes dans une phase d’urbanisation à travers l’Afrique, avec des modes de consommation assez extravertis. Les produits américains, français sont prisés par les consommateurs, même si le « consommer local » revient en force, à la faveur de campagnes de médias ou d’instituts de recherche qui démontrent les qualités nutritionnelles des produits locaux. En attendant, nous importons encore beaucoup de riz, d’Asie, et de blé, que ce soit des pays du Nord, du Brésil ou de Russie.
Comment ces enjeux sont-ils appréhendés par les décideurs politiques ?
La prise de conscience a évolué, mais on n’est pas encore dans un schéma de révolution agricole.
Nous aimerions que la crise engendrée par le Covid-19 soit un levier qui nous amène à repenser les priorités, à reconsidérer l’agriculture, la culture, l’industrialisation, la promotion de l’artisanat, au lieu de toujours mettre en avant les grandes infrastructures qui attirent les investissements. Pour nous, il s’agit d’un nouveau piège. Car la plupart des banques et des institutions financières internationales nous orientent vers des partenariats publics-privés. Sur le papier, c’est comme un idéal incontournable, mais il y a aussi dans ce package une volonté de redynamiser des entreprises européennes et des multinationales. Ce sont elles qui se positionnent sur ces marchés-là. Les acteurs privés locaux ont du mal à gagner des parts de marché dans ces partenariats.
Les infrastructures ne sont-elles pas nécessaires pour écouler et commercialiser les produits issus de l’agriculture locale ?
Certes, on estime qu’il y a entre 15 à 20 % de pertes post-récoltes, en raison des lacunes en matière d’infrastructures de stockage, de transport, mais des ressources considérables sont aussi investies dans des infrastructures de prestige. Il s’agit par exemple, au Sénégal, du train express régional à Dakar, dont on attend le démarrage depuis 4 ans, ou d’autoroutes peu utilisées, alors qu’on aurait pu faire des choix moins ambitieux mais plus utiles.
L’accord établissant la ZLECAf (Zone de libre-échange continentale africaine) est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Ce marché commun devrait dynamiser à terme le commerce intra-africain, alors que le continent a été la destination de seulement 17 % des exportations africaines en 2017. Est-ce une avancée que vous saluez ?
Il y a une prise de conscience quant à la nécessité d’instaurer des dynamiques panafricaines plus poussées, on ne peut que s’en satisfaire. L’Union africaine met en place une vision à long terme, sous-tendue par des programmes, des politiques et des stratégies. Ce que nous craignons toutefois, en observant l’implication des pays du Nord dans le mode de fonctionnement de l’UA, c’est que ces initiatives soient détournées au profit de projets néocoloniaux des pays du Nord et de leurs multinationales.
En janvier, le secrétaire exécutif de la ZLECAf Wamkele Mele a réaffirmé qu’elle était un instrument de décolonisation du commerce africain, ce qui nous a rassurés. Il nous paraît important d’accompagner ces dynamiques-là en pointant les risques éventuels des choix opérés ou non, plutôt que d’être dans une posture de dénigrement. Ce sont de nouveaux projets, produits par des Africains qui connaissent les contraintes ambiantes, nous souhaitons donc les accompagner.
L’Eco, pour remplacer le CFA, cela vous paraît-il aller dans le sens de la souveraineté monétaire à laquelle vous aspirez ?
La question monétaire est très complexe. Nous devons prendre le temps d’élaborer ce chantier-là, pour aboutir à une monnaie unique vraiment utile. Nous devons aussi veiller à faire les bons choix politiques afin que la monnaie unique ouest-africaine ne se retrouve pas sous l’emprise excessive du Nigeria. Il ne s’agit pas de remplacer une domination par une autre.
Il y a aussi une valeur symbolique, liée au fait de changer le nom de cette monnaie…
Bien sûr, même si certains pensent qu’en changeant simplement le nom et pas le contenu, ce n’est pas une réforme sincère… c’est une entourloupe ! Mais il est vrai que le franc CFA reste l’ancienne monnaie coloniale fabriquée à Chamalières. Tant que le président Emmanuel Macron et le ministre de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire pourront peser sur l’avenir de cette monnaie, tant qu’on accusera les présidents ivoirien Alassane Ouattara ou sénégalais Macky Sall de vouloir perpétuer ce système, on n’arrivera pas à cette rupture avec la France que réclame une grande partie de la jeunesse africaine francophone. Et la régénérescence d’une pensée anti-impérialiste et anti-coloniale alimente un sentiment anti-français dans de nombreux pays africains.
Le 18 mai s’est tenu à Paris un sommet sur le financement des économies africaines. Au-delà de cette aide conjoncturelle, estimez-vous qu’il faut revoir les mécanismes d’aide en direction de l’Afrique ?
Les mécanismes de l’aide sont contre-productifs et ne permettent pas de sortir de l’aide. Ils sont ankylosants et empêchent l’Afrique de redéfinir l’agenda à moyen et à long terme d’une souveraineté économique et monétaire véritable. Ils sont également un piège qui accentue l’influence des pays donateurs sur la définition de nos priorités et de nos politiques. Ce sont selon nous des schémas dont il faut sortir. Nous pourrions nous fixer un délai, en développant des stratégies de sortie de l’aide, en mobilisant des ressources locales plus importantes. La fiscalité locale, par exemple, est encore à moins de 10 % des potentialités. Si on gaspille moins, si on restreint les dépenses de prestige, cela peut permettre de moins emprunter à l’extérieur et de se passer de ces fonds à moyen terme. (lepoint.fr)